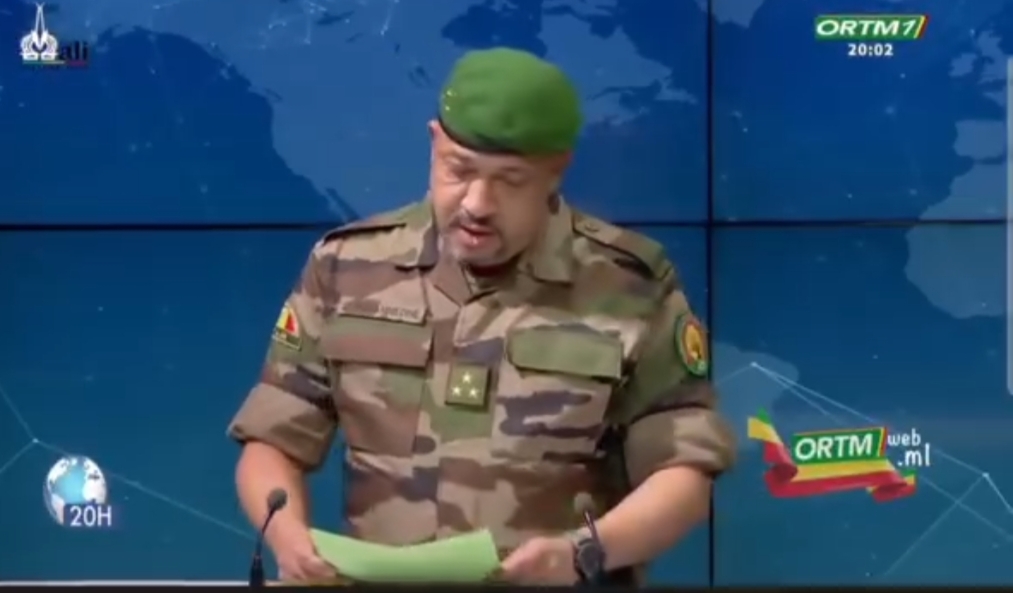Le Mali s’enfonce chaque jour un peu plus dans une crise multidimensionnelle que ni les armes russes ni les discours martiaux de la junte au pouvoir ne parviennent à masquer. Depuis que le colonel Assimi Goïta et son entourage se sont arrogé un mandat transitoire de cinq ans « renouvelable jusqu’à la pacification », le pays connaît une escalade de violences où les populations civiles, déjà éprouvées par une décennie de guerre, sont de plus en plus prises pour cibles.
Le dimanche 14 juillet, la ville de Tombouctou s’est réveillée sous le signe de l’intimidation. La foire hebdomadaire, poumon économique de la région, a été interdite par les mercenaires russes du groupe Africa Corps nouvelle incarnation du défunt Wagner, épaulés par les Forces armées maliennes (FAMA). Des points de commerce de bétail ont été fermés manu militari, et trois civils de la communauté arabe ont été arrêtés au marché de Yobou Tawo sans autre forme de procès.
Goundam, Koulikoro : l’arbitraire comme méthode
Les témoignages s’accumulent et dressent un tableau inquiétant : à Goundam, un enseignant de français, figure locale respectée, a été enlevé le 11 juillet. Aucune revendication, aucun chef d’accusation. Dans la région de Koulikoro, au marché de Boumougnougou, plusieurs civils ont été raflés, puis exécutés à Kamissala, toujours selon des sources locales. Le modus operandi, des enlèvements ciblés, souvent nocturnes, opérés par des hommes armés russophones, accompagnés de soldats maliens.
Pendant ce temps, la guerre asymétrique se poursuit dans le Nord. Le Front de Libération de l’Azawad (FLA), héritier des anciennes rébellions touarègues, a tendu une embuscade à Alkite contre un convoi mixte FAMA-Africa Corps, détruisant plusieurs véhicules. En représailles, quatre localités dont Talahandaq , Tekankante, Intadeyni de la région de Kidal ont été bombardées le 16 juillet par des drones turcs TB2, déployés par l’armée malienne. Bilan officiel : trois ânes tués, deux blessés, au bord d’un puits d’eau à Inkounfe, une localité située à 70 km à l’ouest de la ville de Kidal. Mais l’ironie tragique de ces frappes, inutiles militairement et absurdes humainement, rappelle celle du 8 juillet à Zouéra, où quatre civils dont trois filles, une de 18 mois, une de 4 ans et une adolescente ont péri lors d’un raid sur un hangar servant d’un restaurant pour les foirins de Zouera.

Une stratégie de diversion
Cette militarisation à outrance masque difficilement les failles profondes de l’État malien : économie exsangue, insécurité alimentaire, accès restreint aux soins, voir inexistant dans 70% du territoire malien, effondrement des services publics, isolement diplomatique aggravé par une rhétorique belliqueuse à l’égard des partenaires régionaux et européens. Les discours incendiaires des putschistes, nourris de nationalisme et de ressentiment postcolonial, servent avant tout à détourner l’attention des populations des véritables urgences : eau potable, électricité, emploi, scolarisation.
Le choix de frapper indistinctement des civils nomades Touaregues, Arabes, Peules, Dogonnes ou Soninkés, n’est pas seulement une erreur stratégique. C’est un pari dangereux sur le court terme, qui attise les rancunes ethniques, favorise les replis identitaires et alimente l’obscurantisme que la junte prétend combattre. Ce schéma punitif, à la fois brutal et inefficace, éloigne un peu plus le pays d’une sortie de crise.
Le Mali, archipel d’instabilité
Aujourd’hui, Bamako contrôle à peine 30 % du territoire national, et encore moins de ses frontières, majoritairement non bornées. Le reste est aux mains de groupes armés, d’autodéfense ou jihadistes, ou livré à la loi du plus fort. Dans ce contexte, la politique du coup de force permanent, interne comme externe, ne peut constituer un horizon viable pour le Mali.
À mesure que l’ombre des soldats russes s’épaissit sur les sables du Sahel, les voix civiles s’amenuisent. Il devient urgent que celles-ci soient entendues, non pas comme des cibles, mais comme des piliers de toute paix durable.