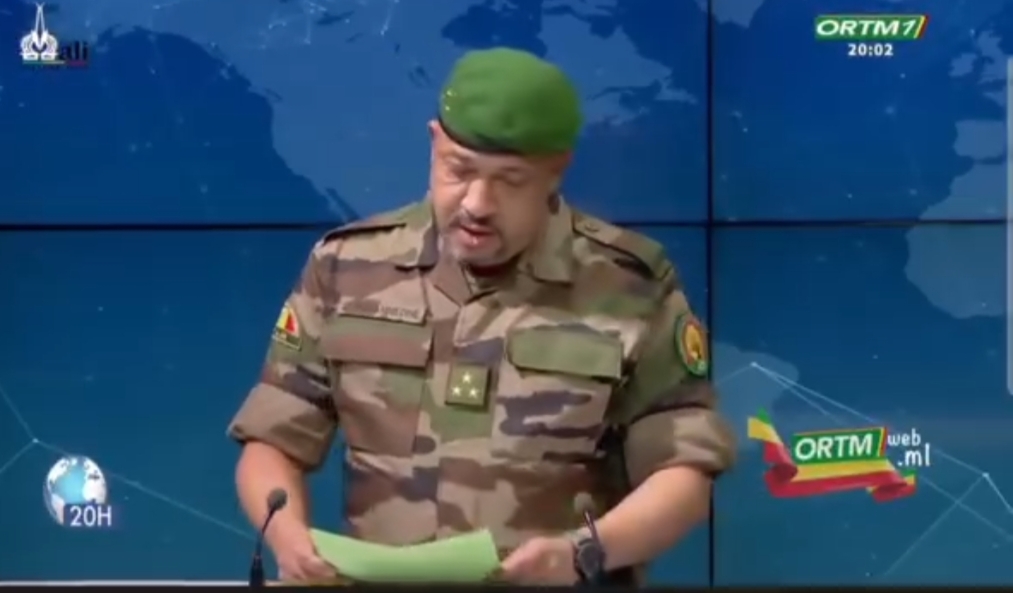Par Mohamed AG Ahmedou
Deux ans après le renversement du président élu Mohamed Bazoum, le Niger semble enlisé dans une crise profonde, sur tous les fronts. Sécuritaire, économique, social et politique : les fondations de l’État vacillent. Dans une tribune virulente et sans concession, l’essayiste nigérien Ilhidji Mohamed Moubareck dénonce une « trahison » orchestrée par un homme qu’il identifie comme « T3 alias Charlie », figure occulte mais omniprésente de la junte actuelle. Au-delà des invectives, la tribune soulève des questions légitimes sur les ressorts du pouvoir, la fragilité démocratique, et les dangers d’un autoritarisme déguisé.

Le récit d’un renversement « injustifiable »
Le 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum, élu en 2021, est renversé par un coup d’État militaire alors que rien, selon Moubareck, ne le justifie : pas de crise politique majeure, pas de dérive autoritaire, pas d’effondrement sécuritaire. Pour lui, il s’agit d’une « odieuse trahison », motivée non par le salut de la nation, mais par les « ambitions personnelles démesurées » d’un homme et de son clan.
Cette lecture du putsch tranche avec les discours habituellement mobilisés pour justifier les renversements militaires en Afrique de l’Ouest, souvent adossés à l’argument de l’échec sécuritaire ou de la corruption. À rebours des cas du Mali ou du Burkina Faso, Moubareck rappelle que le Niger, à la veille du coup, présentait une situation relativement stable : retour des déplacés, baisse des attaques terroristes, croissance soutenue, investissements étrangers, et gouvernance saluée par certains bailleurs internationaux.
Du rêve démocratique à l’État failli
Le tableau post-coup dressé dans la tribune est accablant. En matière sécuritaire, la junte a selon lui provoqué une « faillite totale » : retour du terrorisme dans des régions naguère épargnées, pertes humaines massives, désorganisation de l’armée. L’économie, elle, serait en « banqueroute », étranglée par une mauvaise gestion, la fin des investissements, et la rupture avec les partenaires régionaux.
Sur le plan social, Moubareck décrit un « naufrage abyssal » : écoles fermées, enseignants ignorés, hôpitaux abandonnés. Quant à l’unité nationale, elle serait minée par des manipulations identitaires et linguistiques. Et sur le plan politique, la « souveraineté » tant vantée par la junte cacherait mal une centralisation autoritaire du pouvoir, notamment à travers des assemblées de circonstance, téléguidées selon lui par le même homme de l’ombre : « T3 alias Charlie ».
Une critique à la fois courageuse et contestable
Ce texte, aussi passionné que documenté, soulève une série d’interrogations nécessaires : la légitimité d’un coup d’État dans un contexte non critique, la confiscation de l’État par des intérêts privés, la régression démocratique sous couvert de patriotisme.
Mais il n’échappe pas non plus à certains écueils. Le ton de la tribune, à la limite du pamphlet, s’éloigne parfois du discours analytique pour verser dans l’invective personnelle. La figure de « T3 alias Charlie », omniprésente, devient un bouc émissaire presque caricatural, concentrant tous les maux de la nation. Il n’est jamais nommé explicitement, ce qui rend la vérification des faits difficile, et laisse place aux spéculations. La critique, en se focalisant sur une seule figure, oublie parfois la complexité structurelle de la situation nigérienne, entre ingérences étrangères, tensions internes et fractures sociales profondes.
Une alerte citoyenne plus qu’un manifeste politique
Ilhidji Mohamed Moubareck n’est pas un homme politique. Son texte n’est pas une déclaration partisane, mais plutôt un cri d’alarme citoyen, écrit dans le registre de l’indignation morale. Sa tribune a le mérite de rappeler, à contre-courant d’une normalisation progressive des régimes militaires dans la région, que le retour au constitutionnalisme reste le seul horizon possible pour une nation en quête de stabilité durable.
Mais pour que ce message soit entendu, encore faut-il qu’il soit porté dans un cadre de dialogue, et non de diatribe. Il revient désormais à la société civile, aux intellectuels, mais aussi aux médias libres, de poser les termes d’un débat apaisé mais intransigeant sur l’avenir du Niger.