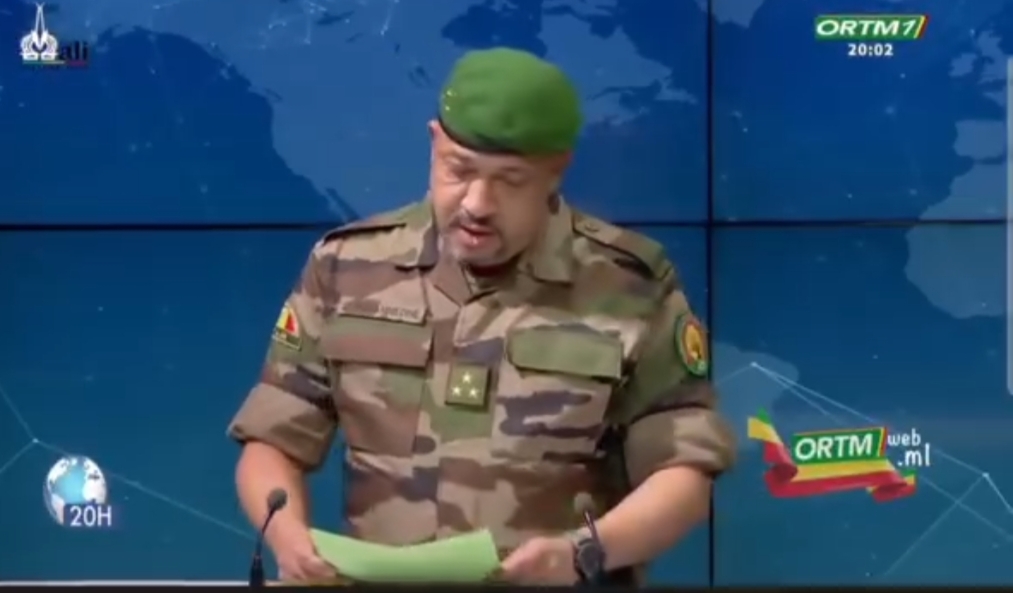Par Mohamed AG Ahmedou

L’ironie de l’histoire, au Mali, prend parfois les traits d’une tragédie antique. Le général Elhadji Ag Gamou, figure militaire emblématique du pays, touareg loyaliste, longtemps perçu comme un pont entre l’État central et les régions du Nord, semble aujourd’hui pris dans un engrenage politique qui dépasse sa propre volonté. À la faveur d’un entretien à huis clos avec le colonel Assimi Goïta, l’homme fort de la transition malienne, le général a infléchi un discours qu’il tenait encore fermement un an plus tôt : « Je ne serai jamais entre la junte et les mouvements de l’Azawad », disait-il en 2023 dans un message sonore largement partagé sur les réseaux sociaux.
Un an plus tard, les lignes ont bougé. Et pas seulement dans la rhétorique. Selon plusieurs sources concordantes, Ag Gamou aurait reçu quelque 600 millions de francs CFA pour remobiliser le Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA), avec pour mission de reprendre les localités stratégiques de Tinzawatene, Achibeyche, Boghassa et Tinassako, passées sous le contrôle du Front de Libération de l’Azawad (FLA) depuis les combats meurtriers du 27 juillet 2024. Ce jour-là, 84 mercenaires russes du groupe Wagner rebaptisé Africa Corps et plusieurs soldats maliens ont été tués, marquant une déroute cuisante pour la junte malienne et ses soutiens russes.

Un revirement aux allures de trahison communautaire
Dans le Nord, cette volte-face suscite incompréhension, colère et accusations de trahison. « Ressaisis-toi, général, avant d’amener tes hommes à l’abattoir », réagit un opposant sur les réseaux sociaux. Dans les rangs des jeunes touaregs, la méfiance est palpable : « Il ne reviendra jamais s’identifier à la communauté après avoir combattu son propre sang. »
Le changement de ton du général est d’autant plus mal perçu qu’il s’accompagne d’une rhétorique alignée sur celle de la junte. Les groupes armés de l’Azawad, naguère interlocuteurs politiques, sont désormais qualifiés de « trafiquants de stupéfiants », comme s’il fallait justifier par l’anathème une guerre fratricide annoncée. En filigrane, un message : le général Ag Gamou est prêt à faire feu contre les siens, pour préserver les intérêts d’un pouvoir militaire en perte de cap.

Un pion stratégique, une stratégie épuisée
À Bamako, certains y voient une tentative désespérée de reconquête symbolique. La junte, fragilisée sur le plan militaire, discréditée sur le plan diplomatique et contestée sur le plan intérieur, cherche à reprendre la main. Ag Gamou, militaire expérimenté, devient alors une carte à jouer, un joker instrumental.
Mais cette stratégie semble déjà entachée d’échecs répétés. En 2022, à Anderboukané, sa milice avait subi de lourdes pertes face à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), au point que le général avait failli y laisser la vie. Les photos de sa carte d’identité militaire, publiées ensuite par l’organisation terroriste, avaient eu l’effet d’un électrochoc.
Depuis, la dynamique ne s’est guère améliorée. Dans la région de Gao comme à Takalote, les appels du général pour lever des troupes rencontrent des refus. La mémoire des pertes passées et l’amertume d’un combat perçu comme absurde refroidissent les ardeurs. « Gamou est un révolutionnaire. Il est juste utilisé par un pouvoir mal intentionné », confie un ancien compagnon d’armes.

Un conflit fratricide maquillé en guerre contre le terrorisme
Le retour de la rhétorique divisionniste – faire s’affronter Touaregs et Arabes – rappelle les plus sombres heures du conflit malien. À défaut de légitimité, la junte semble rejouer une partition éprouvée : opposer les communautés locales pour éviter une coalition rebelle structurée. Mais la ficelle est désormais trop grosse, et le coût humain trop élevé.
Le risque est clair : transformer un conflit politique en guerre communautaire, avec des conséquences incalculables pour la stabilité du pays. Car malgré le discours officiel, ni le GATIA ni le FLA ne sont des entités terroristes. Ce sont des mouvements politico-militaires qui réclament, depuis plus d’une décennie, une refondation de l’État malien.
Le général Ag Gamou, lui, se trouve face à une équation impossible : être à la fois le héraut de l’unité nationale et l’instrument d’une junte divisée, sans devenir le fossoyeur d’un vivre-ensemble déjà fragile.