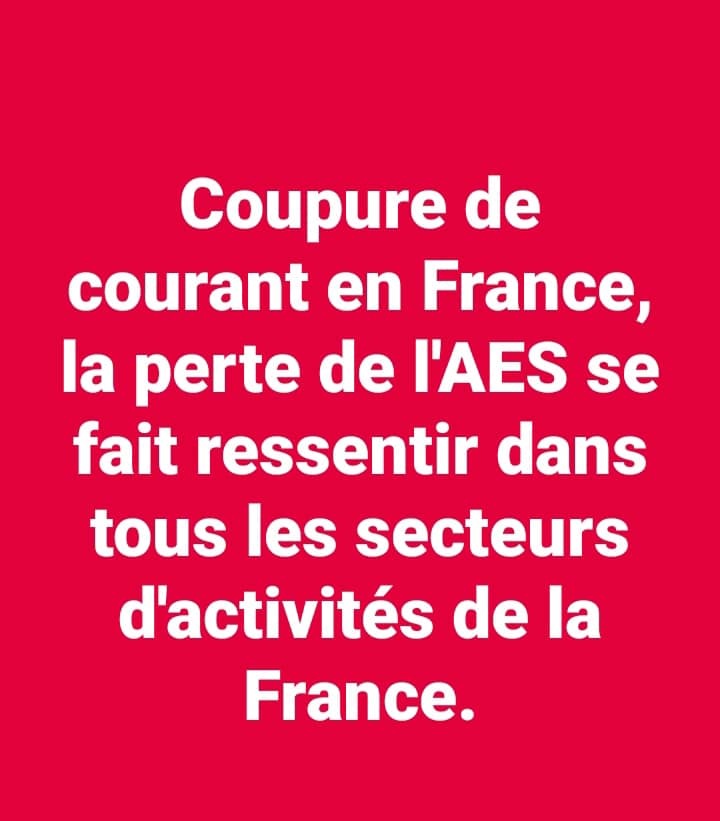
Bamako — Alors que les populations maliennes affrontent une crise multiforme mêlant insécurité persistante, déliquescence des services sociaux de base et chômage chronique des jeunes, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, semble redoubler d’efforts dans l’art de la diversion politique.
Dans un discours récent, largement relayé sur les réseaux sociaux et les médias d’État, le chef de la junte a affirmé en langue Bambara que les coupures d’électricité en France seraient liées à la « perte de l’AES », en référence à l’Alliance des États du Sahel (AES) regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Selon lui, l’influence géopolitique déclinante de la France en Afrique serait désormais perceptible jusqu’à ses infrastructures énergétiques. Une affirmation pour le moins fantaisiste, non étayée par des éléments concrets, et qui tranche avec la gravité des enjeux auxquels fait face le Mali.
Dans la même intervention, le colonel Goïta est allé jusqu’à évoquer le rôle de l’Algérie dans la prise de Kidal, ville stratégique du nord du Mali récemment passée sous contrôle de l’armée malienne et des mercenaires russes du groupe Wagner. Il accuse Alger d’avoir facilité l’évacuation de la population civile avant l’offensive, insistant sur une « collaboration » supposée entre l’Algérie, la France et les groupes terroristes affiliés au JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans). Là encore, aucune preuve tangible ne vient appuyer ces accusations, qui paraissent avant tout destinées à entretenir un récit de victimisation et de rupture radicale avec les anciennes puissances partenaires.
Une rhétorique de plus en plus décorrélée du terrain
Les propos d’Assimi Goïta, qui insistent sur un axe Bamako-Ouagadougou-Niamey présenté comme une alternative souverainiste à l’ordre international, peinent à masquer l’essentiel : les populations de l’AES vivent dans une précarité croissante. À Bamako, les coupures d’électricité sont quotidiennes, l’approvisionnement en eau potable devient erratique, et le sentiment d’abandon s’accentue, notamment dans les régions rurales.
Pour de nombreux observateurs, cette fuite en avant rhétorique vise à faire oublier l’échec des promesses de la junte, tant en matière de sécurité que de développement. Le retrait progressif des forces françaises et onusiennes, loin de s’accompagner d’un renforcement effectif de la souveraineté malienne, a laissé place à un vide opérationnel que ni les armées nationales, ni les partenaires russes ne parviennent à combler durablement.
Un discours sans résultats
Accuser la France et l’Algérie de connivence avec les groupes djihadistes peut flatter certaines sensibilités nationalistes, mais cela ne répond en rien aux attentes urgentes des citoyens maliens. L’école publique est en ruine, les hôpitaux manquent de tout, et les jeunes, désœuvrés, fuient un avenir incertain par les routes périlleuses de l’exil.
En optant pour une politique de communication martiale, fondée sur la dénonciation et la réécriture des rapports de force régionaux, la junte malienne donne l’impression de privilégier la posture à l’action, et l’idéologie à la responsabilité.

