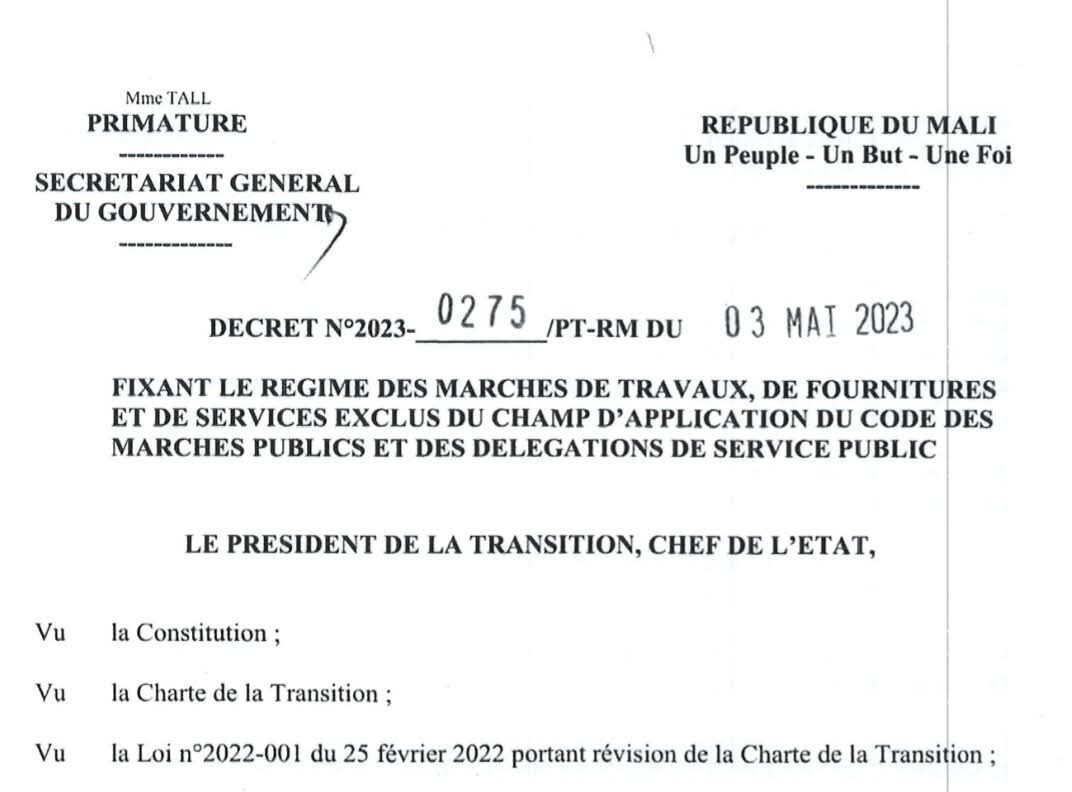Par Sambou Sissoko et Mohamed AG Ahmedou.
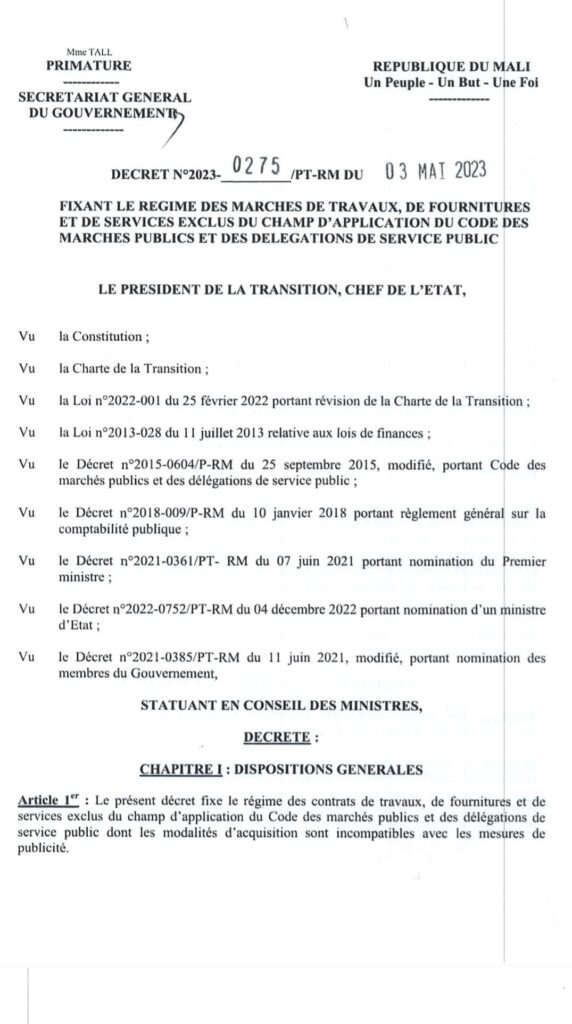
Le 3 mai 2023, un décret passé quasiment inaperçu dans le tumulte politique malien a pourtant scellé une rupture décisive avec les principes élémentaires de transparence, de responsabilité publique et de bonne gouvernance. Portant le numéro 2023-0275/PT-RM, ce texte, signé par les autorités de transition militaires, instaure un régime d’exception dans la passation des marchés publics, au nom de l’« incompatibilité avec les mesures de publicité ».
Derrière cet intitulé flou, presque technique, se cache un véritable cheval de Troie juridique. Désormais, l’État malien peut contracter pour des travaux, fournitures ou services sans appel d’offres, sans contrôle public, sans justification. Le décret ouvre une brèche béante dans le droit malien, offrant aux autorités le pouvoir de contourner toutes les règles de mise en concurrence. Une zone grise contractuelle où tout devient possible, pourvu que l’on déclare que la publicité n’est pas « compatible ».
Un texte à l’apparence anodine, aux conséquences dévastatrices
Présenté comme une simple mesure d’organisation administrative, le décret 0275 est en réalité un outil de contournement massif du Code des marchés publics. Il ne prévoit aucune définition claire des marchés concernés. Ce flou n’est pas une maladresse, c’est un choix : il permet à la junte d’étendre l’exception à toutes les dépenses qu’elle juge sensibles, urgentes, ou simplement gênantes à exposer.
Résultat : les contrats militaires, les services de sécurité, les accords avec des partenaires étrangers ou des sociétés privées peuvent être passés en toute opacité, sans rendre de comptes ni au public ni aux institutions de contrôle.
L’institutionnalisation du clientélisme
Le plus inquiétant réside dans la logique qui sous-tend ce décret. En contournant le cadre légal des marchés publics, le pouvoir militaire s’octroie la capacité de distribuer des contrats à ses proches, ses soutiens ou ses partenaires économiques, sans concurrence ni justification. Une porte ouverte au clientélisme, aux conflits d’intérêts et à la corruption systémique.
Dans un Mali déjà fragilisé par des décennies de mauvaise gestion, ce décret sonne comme une régression historique. Il rappelle les heures sombres de la dictature de Moussa Traoré, ou encore les dérives de l’attribution gré à gré sous ATT. Mais cette fois-ci, l’absence totale de contre-pouvoirs – Parlement dissous, presse muselée, partis politiques neutralisés – rend la contestation presque impossible.
Une économie nationale étouffée
Les premières victimes de ce décret seront les PME maliennes, déjà marginalisées par l’accès difficile aux marchés publics. Les rares appels d’offres existants deviennent désormais facultatifs. Ce sont les entreprises les plus proches du régime, ou les plus silencieuses, qui seront servies. Une logique qui tue la concurrence, étouffe l’innovation et bloque toute dynamique de développement endogène.
Un blanc-seing pour les réseaux de prédation
Ce décret ne vient pas de nulle part. Il survient dans un contexte d’accords opaques avec des acteurs controversés comme le groupe paramilitaire Wagner, certaines sociétés de BTP ou de sécurité. Ces marchés, souvent chiffrés à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, échappent à tout contrôle. Le décret 0275 leur donne désormais une base juridique. L’État malien n’est plus simplement discret : il s’autorise à cacher ses actes.
Une non-publication révélatrice
Comble du cynisme, le décret ne figure même pas dans le Journal officiel n°13 du 12 mai 2023, là où il aurait dû être publié pour être opposable au public. Une omission volontaire ? C’est ce que dénoncent plusieurs observateurs. Cette dissimulation prouve que les auteurs du décret eux-mêmes sont conscients de sa portée explosive.
La souveraineté, prétexte à l’impunité
Les défenseurs du décret invoqueront les habituels arguments de souveraineté, de sécurité ou d’urgence. Mais il ne s’agit pas ici de protéger l’État : il s’agit de le dévaliser en silence. Le décret 0275 n’est pas un instrument de souveraineté, c’est un outil de prédation légalisée. Il transforme la gestion publique en chasse gardée d’un clan, qui confond les finances nationales avec un trésor de guerre à redistribuer entre alliés.
Un signal d’alerte
Ce décret n’est pas un simple texte administratif. C’est une alerte rouge pour l’avenir du Mali. Il confirme que le régime en place, après avoir capturé le pouvoir par la force, cherche maintenant à capturer l’économie par la loi. En verrouillant l’accès aux ressources, en court-circuitant la concurrence, en criminalisant toute critique, il fait basculer le pays vers une kleptocratie militarisée.
À ceux qui se demandent pourquoi les écoles ferment, pourquoi les hôpitaux manquent de tout, pourquoi les routes se détériorent, pourquoi les salaires stagnent : la réponse est dans ce décret. Le Mali est pillé. Et désormais, c’est légal.