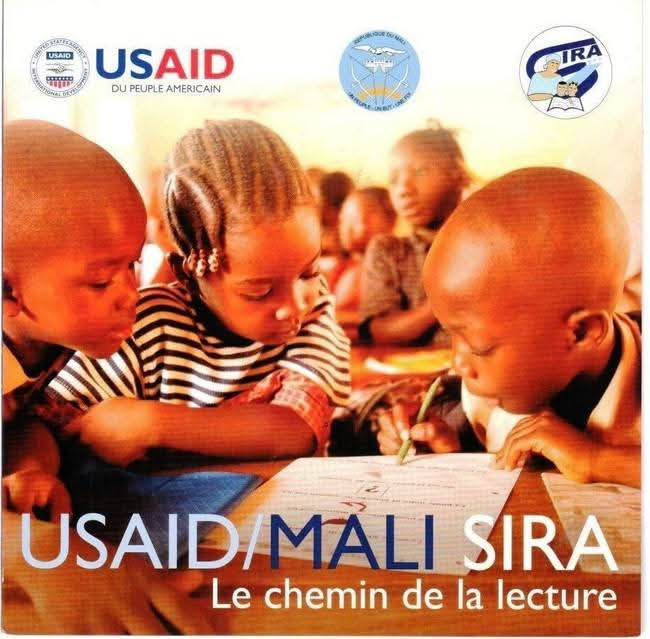
Le 31 juillet 2025 marquera une rupture symbolique et concrète dans la coopération entre le Mali et les États-Unis. L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) mettra officiellement fin à ses activités dans le pays. Une décision aux répercussions lourdes : 39 milliards de FCFA d’aide annuelle supprimés et plus de 35 000 Maliens directement affectés par la perte de leur emploi.
Derrière ces chiffres, ce sont des vies, des familles, des services de santé et des dynamiques locales qui vacillent. Le projet USAID Keneya Sinsin Wale, pilier de la coopération sanitaire américaine dans les régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala et San, s’éteint dans un silence glaçant. Ces régions rurales, fragiles et souvent oubliées du centre, paieront le prix d’une crise diplomatique qu’elles n’ont ni provoquée ni souhaitée.
Une coopération sabordée par l’idéologie
Depuis 2020, la junte militaire au pouvoir, incarnée par le colonel Assimi Goïta, s’est engagée dans une stratégie de rupture avec les partenaires occidentaux traditionnels, au nom d’une souveraineté recouvrée. Dans les faits, cette stratégie vire à l’isolement. La France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Union européenne, et désormais les États-Unis, ont mis un terme à une partie ou à l’ensemble de leurs programmes. Derrière les slogans martelés sur les places publiques de Bamako, la réalité géopolitique rattrape l’utopie d’un repli national.
Certes, la critique d’un partenariat inégal et parfois condescendant avec les pays occidentaux est légitime. Mais à quoi bon dénoncer une dépendance sans construire de véritables alternatives crédibles ? La Russie, désormais principal soutien militaire de Bamako, n’a ni les moyens ni la volonté d’assumer le rôle d’un bailleur de développement. Quant à la Chine, elle observe, sans s’engager ouvertement dans un pays classé comme « État failli » depuis 2006 par les Nations unies.
Une souveraineté de façade
En proclamant une souveraineté qui ne s’appuie ni sur une économie viable, ni sur des institutions fortes, la junte confond indépendance et autarcie. Elle semble oublier que le concept même de souveraineté repose d’abord sur la capacité de l’État à fournir des services publics à sa population. Or, ce sont précisément ces services qui se délabrent à vue d’œil, notamment dans le secteur de la santé.
Le départ de l’USAID n’est pas seulement une décision politique : c’est un signal d’alarme. Il souligne l’échec d’une politique étrangère réactive, plus soucieuse de symboles que de résultats. Et pendant que les élites militaires jouent à la guerre froide version sahélienne, ce sont les infirmières de Bougouni, les agents communautaires de San, et les femmes enceintes de Koutiala qui trinquent.
Le Mali, otage d’un discours populiste
Le retrait américain confirme une tendance préoccupante : l’internationalisation d’un désengagement. Derrière la rhétorique nationaliste, la population malienne reste l’otage d’un régime qui mise sur l’isolement stratégique comme levier de légitimité interne. En qualifiant de « victoires » diplomatiques les départs successifs de partenaires, la junte maquille un isolement croissant en choix souverain.
Mais il ne suffit pas de rejeter l’Occident pour faire illusion. La souveraineté, la vraie, se construit. Elle ne se proclame pas dans les discours, elle se prouve dans les actes : accès à la santé, à l’éducation, à la justice. Pour l’instant, ces domaines ne cessent de se détériorer, fragilisant encore un peu plus un État déjà vacillant.
l’illusion souverainiste
Le retrait de l’USAID du Mali est un tournant. Il n’est pas un simple épisode dans la série des ruptures diplomatiques : c’est une alerte majeure sur la viabilité de la gouvernance actuelle. En refusant de composer avec ses partenaires historiques sans proposer d’alternative viable, la junte expose les populations maliennes à un vide mortel. La souveraineté ne peut pas être une idéologie : elle doit être un projet.

